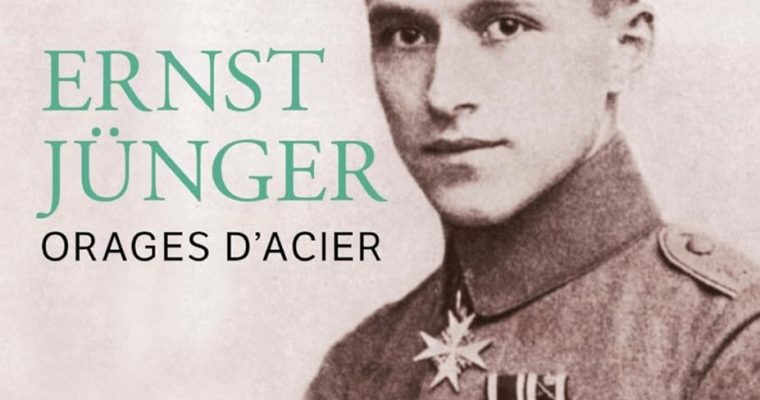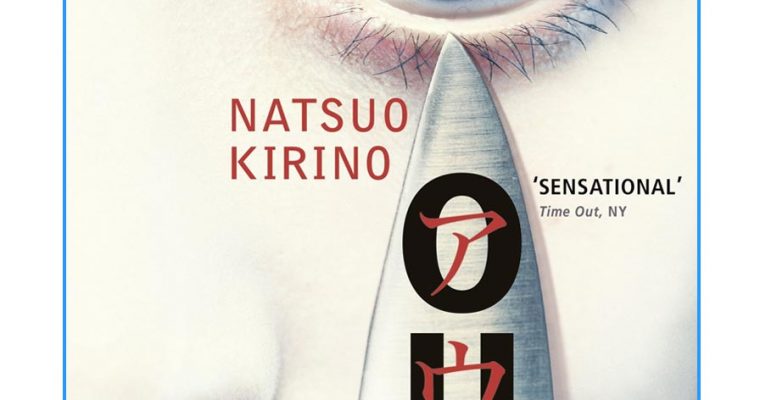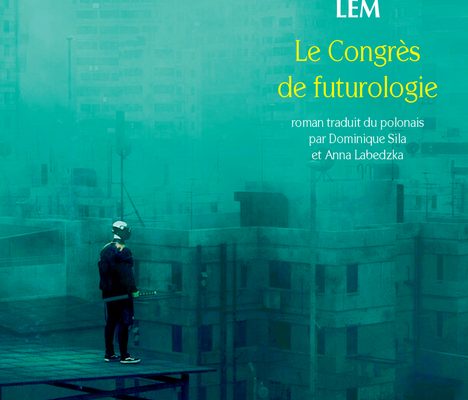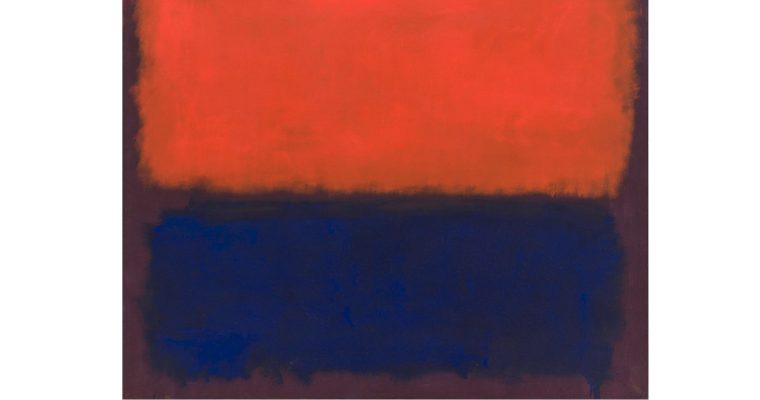Cordoue, forêt de piliers, intime imbrication
Comme Hagia Sophia à Istambul, la Mezquita catedral, mosquée cathédrale de Cordoue, absolument fascinante, m’a fait rêver pendant des années à son obscure forêt de colonnes. Construite sur un temple romain dédié à Janus, puis sur une église Wisigoth, l’immense mosquée aligna ses centaines de …